
Même si la trésorerie permet de couvrir les besoins de fonctionnement, absorber les imprévus, rassurer les partenaires bancaires, cela ne justifie pas une gestion passive. Plus encore dans un contexte où les outils de placement comme la SCPI se sont considérablement diversifiés et démocratisés.
Une question revient donc auprès des chefs d’entreprise souhaitant faire fructifier leur trésorerie dormante : De quelles solutions disposent-ils pour optimiser leur trésorerie ?
Comprendre ce qu’est la trésorerie pour mieux la valoriser
La trésorerie correspond à l’ensemble des liquidités immédiatement mobilisables par l’entreprise. Elle inclut à la fois le solde bancaire disponible et les encaissements en attente. Elle assure le bon fonctionnement du cycle d’exploitation et renforce la stabilité financière de l’organisation.
Il convient toutefois d’introduire une distinction. La trésorerie opérationnelle représente les liquidités nécessaires au fonctionnement quotidien, comme le paiement des salaires, des charges et des fournisseurs. À l’inverse, la trésorerie excédentaire provient des bénéfices accumulés et ne sert pas directement l’activité courante. Également appelée trésorerie stable, elle est un levier de performance à condition d’être investie pour contribuer à la croissance et à la création de valeur.
Une conjoncture économique qui pèse sur les liquidités
Après une longue période sans inflation, la hausse des prix s’est installée durablement en France, atteignant 4,9% en 2023 puis 3% en 2024. Cette progression réduit la valeur réelle des liquidités non investies et entraîne une perte de pouvoir d’achat pour les trésoreries restées inactives. En d'autres termes, ne pas placer sa trésorerie revient à en accepter sa lente érosion.
Dans le même temps, le contexte économique et politique international a accentué la volatilité des marchés financiers. Les tensions géopolitiques, les variations des taux d’intérêt et l’incertitude autour des cycles économiques provoquent des mouvements brusques sur les marchés actions comme obligataires. Face à cette double contrainte – inflation persistante et instabilité financière – les entreprises et les investisseurs doivent adapter leur stratégie. Il devient nécessaire de diversifier les allocations pour protéger la valeur des actifs et sécuriser les placements.
Définir son profil de risque : entre sécurité, liquidité et rendement
Les entreprises disposent aujourd’hui d’un large éventail de solutions pour placer leur trésorerie. Il peut s’agir de supports sécurisés comme le compte à terme, de fonds obligataires ou de produits monétaires, mais également de placements immobiliers tels que les SCPI, voire d’instruments financiers plus dynamiques pour les profils recherchant davantage de performance.
Le choix de la solution dépend donc de la stratégie d’investissement retenue. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un arbitrage classique entre trois notions indissociables :
- la sécurité du capital,
- la liquidité des fonds,
- le rendement attendu.
Ces trois critères sont complémentaires et sans hiérarchie prédéfinie. L’équilibre recherché variera selon la nature de l’entreprise, ses contraintes de trésorerie et son appétence au risque. Certaines privilégieront la préservation du capital, d’autres la disponibilité immédiate des fonds, quand d’autres encore chercheront à maximiser la performance en acceptant un horizon de placement plus long.
Tour d’horizon des solutions classiques de placement de sa trésorerie
Plusieurs supports de placement peuvent trouver leur place dans une stratégie financière d’entreprise. Chacun repose sur des approches différenciées, en fonction du degré d’exposition accepté et des objectifs. On distingue plusieurs solutions ;
Le compte à terme ou CAT
Le compte à terme repose sur un principe simple : l’entreprise confie une somme à sa banque pour une durée définie, en échange d’un taux d’intérêt fixé à l’avance. En contrepartie, les fonds sont bloqués jusqu’à l’échéance. À terme, le capital est restitué, majoré des intérêts convenus.
Plébiscité pour sa simplicité, le compte à terme offre une garantie totale du capital. Il convient donc parfaitement aux entreprises qui privilégient la sécurité à court ou moyen terme, ou qui souhaitent immobiliser une part de leur trésorerie sans s’exposer aux fluctuations de marché.
Les rendement restent toutefois assez modestes. De plus, la liquidité fait partie de l’une des contraintes. Sauf clause spécifique, un retrait anticipé entraîne des pénalités, réduisant l’intérêt de l’opération.
Les fonds obligataires
Les fonds obligataires peuvent offrir une alternative à mi-chemin entre les comptes à terme et les fonds actions. Ces produits d’investissement sont composés d’obligations émises par des États ou des entreprises. En investissant dans un fonds obligataire, l'entreprise prête son argent à une diversité d’acteurs, avec un niveau de risque mesuré. Ce type de fonds vise en effet à servir un revenu stable et régulier, ce qui en fait un instrument particulièrement recherché par les entreprises qui souhaitent sécuriser leur trésorerie tout en générant un rendement constant.
La diversification, notamment grâce à l’ensemble des titres dans le portefeuille est un des atouts de ce type de placement. L’autre avantage est assurément sa liquidité. Contrairement au compte à terme, les parts peuvent être revendues à tout moment.
Les fonds action
Investir en actions, c’est accepter la part d’incertitude qui accompagne une éventuelle promesse de performance. En choisissant ce produit d’investissement, l’entreprise se tourne vers un support de croissance, potentiellement très rentable, mais aussi très exposé à la volatilité des marchés financiers.
Contrairement aux précédents placements, plus sécurisés, les actions n’offrent aucune garantie de capital. Leur valeur dépend directement de la santé économique des sociétés détenues et de l’évolution générale des marchés.
Les fonds action regroupent un grand nombre de titres et permettent de diluer le risque sur plusieurs entreprises, secteurs d’activité impactés aux zones géographiques. Cette diversification limite l’impact négatif d’une contre-performance isolée et ouvre l’accès à des univers d’investissement variés, y compris des thématiques spécifiques comme l’innovation technologique ou environnementale à travers les critères ESG.
Ce support convient davantage aux entreprises disposant d’une trésorerie excédentaire et stable, capables d’immobiliser une partie de leurs liquidités sur le moyen ou le long terme. L’investissement en actions ne doit pas être perçu comme une réserve de liquidité immédiate, mais plutôt comme un moteur de performance destiné à accompagner la croissance de l’entreprise sur le long terme.
En définitive, il convient de rappeler que les fonds actions s’inscrivent dans un marché particulièrement spéculatif. Leur potentiel de rendement élevé s’accompagne d’un risque accru de perte en capital, lié aux aléas économiques, aux cycles boursiers et aux fluctuations parfois brutales des marchés. Ils représentent donc une solution de placement à manier avec précaution, réservée aux entreprises prêtes à assumer cette part d’instabilité inhérente aux marchés financiers.
Le private equity
Le private equity ou capital-investissement est l’une des formes les plus risquées de placement de trésorerie. L’entreprise investit en effet dans des sociétés non cotées, souvent jeunes, innovantes ou en transformation, par le biais de fonds spécialisés.
Ce support d’investissement s’adresse à une cible restreinte : des structures prêtes à immobiliser une partie de leur trésorerie pendant plusieurs années (généralement 5 à 8 ans), sans perspective de retrait anticipé. En contrepartie de cette illiquidité, le potentiel de performance est élevé. Le private equity vise des taux de rendement bien supérieurs à ceux des actifs traditionnels et contribue au développement concret de l’économie réelle.
L’engagement est tout de même fort. Il y a un fort risque de perte en capital. Le ticket d’entrée est souvent élevé, entre 100.000 et 250.000 euros, faisant de cet outil un produit réservé à des entreprises capables d’investir un montant conséquent.
La SCPI
La Société Civile de Placement Immobilier, pour SCPI, s’impose progressivement comme une alternative pertinente. En alliant mutualisation, rendement stable et gestion simplifiée, elle constitue une réponse concrète aux attentes des dirigeants d’entreprise soucieux de valoriser leur trésorerie et d’investir dans l’immobilier sans contrainte de gestion.
La SCPI permet à une entreprise d’acquérir des parts dans une société foncière qui se constitue un patrimoine immobilier professionnel comme des bureaux, commerces, cliniques ou encore plateformes logistiques en France ou à l’étranger (parfois même au-delà de l’Europe). En contrepartie de cet investissement, les entreprises, considérées comme personnes morales, perçoivent des revenus locatifs au prorata des parts détenues.
L’entreprise devient ainsi introduite à l’immobilier d’entreprise sans en supporter la gestion. C’est la société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers qui sélectionne les actifs, réalise les acquisitions, assure l’entretien, gère les locataires et procède aux éventuels arbitrages. Les entreprises n’ont plus qu’à percevoir leurs revenus locatifs tout en conservant une disponibilité totale sur leur cœur d’activité.
Ce fonds d’investissement est d’autant plus appréciable par ses modalités de souscription, notamment l’investissement dans la SCPI en démembrement, particulièrement attractif pour les entreprises cherchant à optimiser leur trésorerie. En effet, elles peuvent séparer la pleine propriété et investir soit dans l’usufruit ou la nue-propriété ; une approche qui séduit davantage les acteurs économiques.
Plus de 100 SCPI comparées avec toutes les données
Notre Top 10 des SCPI recommandées
Tous les taux de distribution 2025
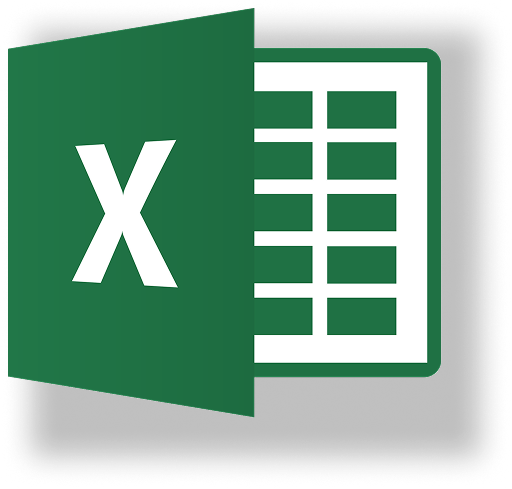
Usufruit temporaire
Le démembrement de propriété sépare la propriété en deux types de droits : l’usufruit et celui de la nue-propriété. L’entreprise peut en effet acquérir uniquement l’usufruit des parts et jouir de celles-ci durant une durée prédéfinie (généralement de 5 ans à 15 ans). Pendant cette période, elle perçoit tous les revenus locatifs sans détenir la nue-propriété, c’est-à-dire le droit de posséder les parts. À échéance, les parts de l’usufruit reviennent au nu-propriétaire, qui devient plein-propriétaire des parts de SCPI.
Pour approfondir ce mécanisme d’investissement et découvrir leurs avantages concrets pour votre entreprise, France SCPI vous invite à consulter l’article dédié au placement de sa trésorerie en SCPI.
| Type de placement | Durée conseillée | Rendement estimé | Niveau de risque | Délai de liquidité |
| Compte à terme | 3 mois à 3 ans | 2,5% | Capital garanti | Faible |
| Fonds obligataires | 1 à 5 ans | 4 % | Modéré | Forte |
| SCPI | 5 ans | 4 % à 11 % | Modéré | Restreinte |
| Produits structurés | Moyen à long terme | Variable (4 % à 10 %) | Variable | Forte |
| Actions (fonds ou ETF) | Plus de 8 ans | 10 % (moyenne historique) | Élevé (forte volatilité) | Forte |
| Crypto-actifs | Variable | Très variable | Très élevé | Forte |
| Crowdfunding | 6 mois à 3 ans | 4 % à 12 % (selon projet) | Élevé (défaut possible) | Faible |
| Private Equity | Plus de 8 ans | 7 % à 15 % | Élevé | Faible |
Prenez rdv sur le créneau qui vous convient.
Soyez accompagné pour être sûr de votre choix


Titulaire d’une licence LEA (Université de Nanterre) et d’une licence professionnelle en création digitale (IUT de Paris), Rabia consolide son expertise en rejoignant France SCPI. Actuellement étudiante en Master PGE à l’INSEEC, elle se consacre désormais aux enjeux du marketing...
Tous ses articles









